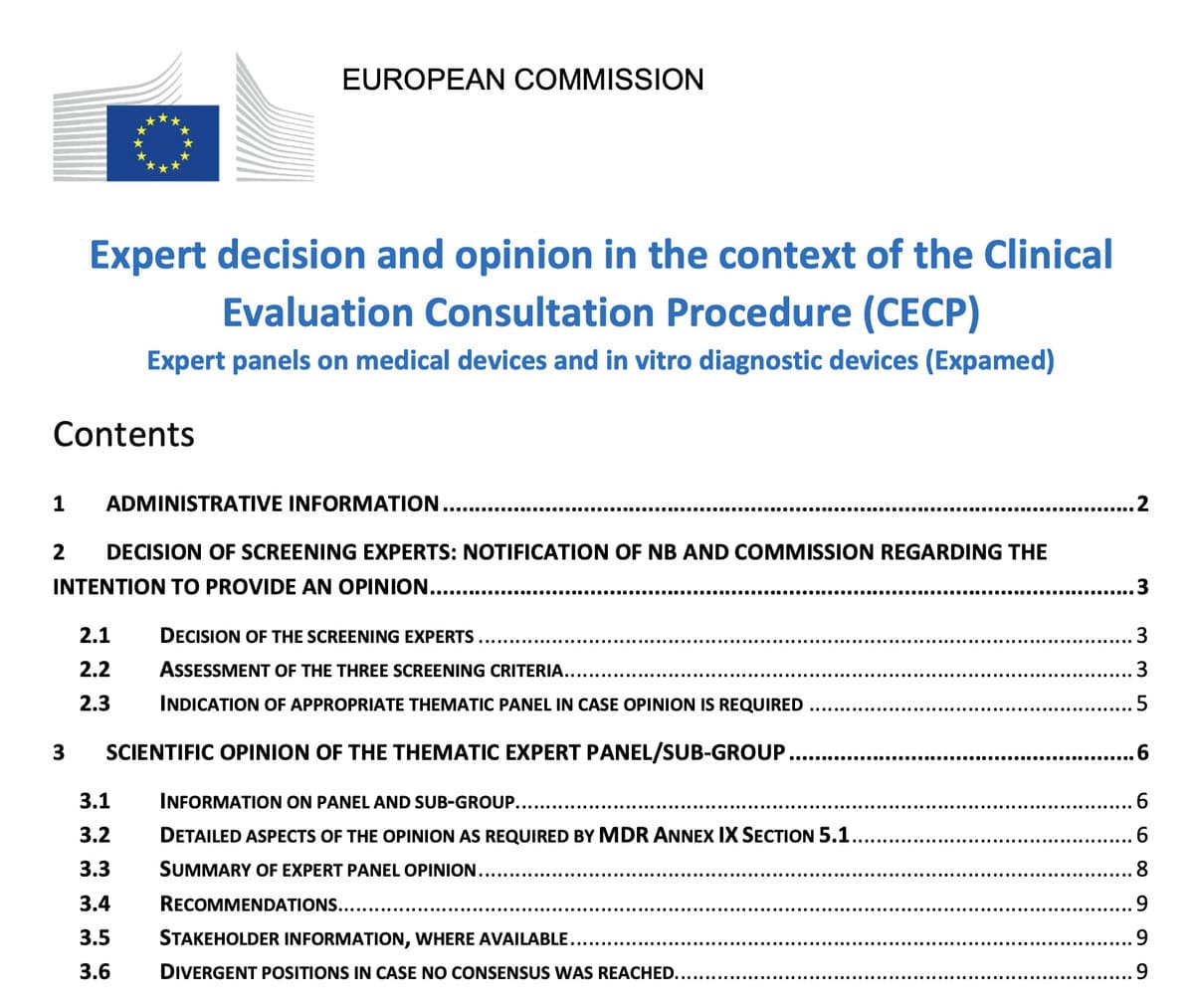
Procédure CECP : à quoi doivent être vigilants les fabricants de dispositifs médicaux ?
Actualites
1. CECP : un filtre redoutable pour les dossiers cliniques mal préparés
Le Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (MDR) a introduit une nouveauté encore trop méconnue de nombreux fabricants : la procédure de consultation d’évaluation clinique, ou CECP (Clinical Evaluation Consultation Procedure).
Concrètement, cette procédure s’applique à certains dispositifs médicaux à haut risque, notamment :
- les dispositifs de classe III implantables,
- les dispositifs de classe IIb qui administrent ou retirent un médicament (ex. : pompes, injecteurs, ventilateurs).
Dès qu’un dispositif entre dans ce champ, le MDR impose qu’un panel d’experts indépendants soit consulté pour donner un avis scientifique sur la solidité des données cliniques. Mais attention : ces experts ne relisent pas le rapport du fabricant (CER). Ils relisent le rapport d’analyse clinique de l’organisme notifié – le CEAR (Clinical Evaluation Assessment Report). Et ils n’ont pas pour mission d’être indulgents.
Exemple concret : l’avis CECP du 24 juin 2025
Le 24 juin 2025, la Commission européenne a publié un avis scientifique particulièrement sévère concernant un ventilateur mécanique pour patients adultes et pédiatriques. Le dispositif, soumis au marquage CE par un organisme notifié (n° 2696), a déclenché une CECP. Et le panel d’experts a rendu un avis très critique, pointant des lacunes majeures dans le dossier : incohérences entre documents, allégations cliniques douteuses, PMCF mal conçu, etc.
Un mécanisme souvent sous-estimé Dans les faits, beaucoup de fabricants – et parfois même certains organismes notifiés – sous-estiment la rigueur attendue par ces panels d’experts. On pense souvent qu’il suffit de “cocher les cases”, ou que le CER suffit à convaincre. Mais la CECP agit comme un révélateur : elle teste la cohérence globale du dossier, y compris le sérieux de l’évaluation faite par l’ON.
Et quand le niveau attendu n’est pas au rendez-vous ? Ce n’est pas juste une observation marginale. C’est potentiellement un blocage complet du marquage CE.
2. Qu’est-ce que la CECP (Clinical Evaluation Consultation Procedure) ?
La procédure CECP dispositif médical, introduite par le règlement MDR (article 54), est une étape obligatoire dans certains cas, et hautement stratégique dans l’évaluation clinique de dispositifs à haut risque. Elle fait intervenir un panel d’experts indépendants mandatés par la Commission européenne, chargés de donner un avis scientifique sur l’évaluation clinique réalisée par l’organisme notifié.
Dans quels cas la CECP s’applique-t-elle ?
La procédure CECP ne concerne qu’une partie des dispositifs médicaux à haut risque. Elle s’applique obligatoirement :
- Aux dispositifs implantables de classe III, sauf si des exemptions s’appliquent (dispositifs bien établis, équivalents à un produit du même fabricant…).
- Aux dispositifs de classe IIb qui sont conçus pour :
- administrer un médicament ou un produit d’origine corporelle,
- retirer des substances du corps humain (ex. : dialyseurs, systèmes d’oxygénation extracorporelle).
À noter : ce ne sont pas les fabricants qui déclenchent la CECP, mais l’organisme notifié, une fois son évaluation clinique terminée, s’il entre dans le champ de l’article 54.
Qui fait quoi ? Rôles du fabricant, de l’organisme notifié et du panel
- Le fabricant rédige le CER (Clinical Evaluation Report), document central qui compile les données cliniques et démontre la sécurité et la performance du dispositif pour sa destination.
- L’organisme notifié (ON) analyse le CER, le compare avec le plan d’évaluation clinique (CEP), les résultats de PMCF s’il y en a, et rédige son propre rapport : le CEAR (Clinical Evaluation Assessment Report).
- Le panel d’experts relit uniquement le CEAR, pas le CER. Sa mission est de vérifier la rigueur et la pertinence scientifique de l’analyse faite par l’ON, et d’alerter si la démonstration du rapport bénéfice/risque est jugée insuffisante, incohérente ou non étayée.
Ce que le panel évalue vraiment : le CEAR, pas le CER
C’est un point souvent mal compris par les fabricants : le panel n’évalue pas directement les preuves cliniques du fabricant, mais la façon dont l’organisme notifié a interprété et jugé ces preuves.
En d’autres termes, si votre dossier est faible, peu clair, mal structuré ou incohérent, l’ON peut passer à côté de points critiques… et c’est à ce moment-là que le panel intervient pour tirer le signal d’alarme.
Ce qui est évalué, ce n’est pas seulement le fond, mais aussi la qualité de l’évaluation elle-même. Et cela peut remettre en cause toute la procédure de certification.
3. Retour d’expérience : un ventilateur recalé par la CECP (juin 2025)
Le 24 juin 2025, la Commission européenne a publié une opinion scientifique particulièrement critique dans le cadre d’une procédure CECP concernant un ventilateur mécanique destiné à des patients adultes et pédiatriques. Ce retour d’expérience est un parfait révélateur des attentes – et des exigences – des panels d’experts.
Contexte du dispositif concerné
Le dispositif évalué était un ventilateur de classe IIb, destiné à maintenir artificiellement la respiration en cas d’insuffisance respiratoire. Le fabricant le destinait à un usage hospitalier, y compris chez des enfants dès 1 kg.
Le dossier de marquage CE a été soumis par un organisme notifié (n° 2696) en octobre 2024. En raison du niveau de risque, une consultation CECP a été déclenchée, comme le prévoit l’article 54 du MDR.
Ce qui a déclenché la procédure de consultation
Trois éléments ont motivé la décision des experts de rendre un avis formel :
1. Le dispositif était nouveau sur le marché, sans antécédents cliniques établis.
2. Le rapport d’évaluation clinique de l’ON (CEAR) présentait des incohérences majeures.
3. Il existait un risque potentiel important pour la sécurité des patients, du fait de ces incertitudes.
Les 7 erreurs clés relevées par le panel d’experts
Voici les principales critiques formulées dans l’avis CECP – toutes révélatrices de ce qu’il ne faut pas faire en matière d’évaluation clinique de dispositifs médicaux :
1. Nom du dispositif incohérent
Dans les documents soumis, le dispositif est appelé AirVENT60 dans le CEAR et Vent 2 dans le CER. Aucun justificatif n’est fourni. Une incohérence basique… mais déjà problématique.
2. Cible patient mal définie
Le CEAR mentionne des patients >5 kg, tandis que le CER parle de >1 kg (volumes courant de 10 ml). Les experts rappellent qu’un volume courant >50 ml n’est pas adapté aux nouveau-nés ou à la majorité des nourrissons.
3. Utilisation prévue incomplète
Le CEAR indique un usage avec masque ou trachéotomie, mais ne fait aucune mention de l’intubation par sonde endotrachéale – pourtant courante en ventilation mécanique.
4. Allégation clinique erronée
Le CEAR affirme que le dispositif “réduit la pression intracrânienne”. Les experts notent que, sauf cas très spécifiques, la ventilation mécanique augmente généralement cette pression.
5. Instruction d’oxygénation dangereuse
Le CER recommande d’interrompre l’alimentation en oxygène avant l’arrêt de la ventilation, puis de ventiler plusieurs cycles sans oxygène. Les experts jugent cette recommandation non sécuritaire et irréaliste en pratique clinique.
6. Contradiction dans le plan PMCF
Le plan PMCF prévoit d’inclure des patients ventilés en ambulatoire (cliniques, centres du sommeil), et d’exclure les patients intubés ou trachéotomisés. Cela contredit la destination hospitalière du dispositif décrite ailleurs.
7. Documents inutilisables
Les figures présentes dans les documents sont jugées de mauvaise qualité, mal lisibles, et parfois incohérentes, rendant l’interprétation difficile.
Ce que cela révèle sur la rigueur attendue
Cet avis met en lumière une exigence fondamentale : la cohérence et la traçabilité clinique ne sont pas optionnelles. Les experts ne cherchent pas des failles juridiques ou des oublis de forme : ils pointent des décalages factuels, techniques et cliniques entre les documents. Et ils attendent :
- une maîtrise claire de la destination du dispositif,
- une logique clinique robuste,
- un alignement rigoureux entre le CER, le PMCF, les indications et les modes d’utilisation.
Ce cas illustre aussi que le niveau d’exigence du panel dépasse souvent celui de l’organisme notifié. Le CEAR a été rédigé, validé, et transmis… mais n’a pas résisté à la lecture critique des experts.
4. Fabricant : à quoi devez-vous être vigilant ?
Quand un dispositif entre dans le champ de la CECP, la question n’est plus “Est-ce que mon dossier est complet ?”, mais bien “Est-ce qu’il résiste à un examen clinique indépendant, rigoureux et sans indulgence ?”
La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de pièges peuvent être évités si l’on s’y prend bien dès le départ.
Voici les points de vigilance essentiels pour un fabricant de dispositif médical confronté à la procédure CECP.
Ce que vous devez absolument anticiper
1. Assurez-vous d’une cohérence parfaite entre les documents
Le CER, le plan d’évaluation clinique (CEP), le PMCF plan, l’IFU, la SSCP… tout doit raconter la même histoire. Un nom de dispositif, une indication ou une cible patient incohérente entre deux documents peut suffire à affaiblir la crédibilité du dossier.
2. Vérifiez les indications, la cible patient et les modes d’utilisation
Pas de place pour l’ambiguïté : l’âge, le poids minimal, la voie d’administration, le cadre d’usage (hôpital, domicile…), tout doit être clairement défini et justifié.
3. Ne sur-vendez pas les bénéfices cliniques
C’est tentant de vouloir rassurer les ON et valoriser son produit. Mais affirmer qu’un dispositif “réduit la pression intracrânienne” sans preuve solide, c’est prendre un risque réglementaire… et éthique.
4. Préparez un PMCF crédible et ciblé
Un plan PMCF générique, sans lien avec les risques cliniques, n’est pas crédible. C’est un alibi, et les experts ne s’y trompent pas. Posez-vous la vraie question : qu’est-ce que je dois encore démontrer après mise sur le marché ?
5. Anticipez la logique CECP dès la rédaction du CER
Même si le panel ne lit que le CEAR, il est essentiel de structurer le CER comme un document opposable et traçable. Chaque allégation doit être soutenue par des sources, chaque choix méthodologique justifié, chaque lien vers les risques documenté.
6. Challengez votre organisme notifié
Le CEAR est rédigé par l’ON, mais vous êtes en droit de demander à le relire (ou au minimum, à poser des questions sur sa clarté, sa cohérence et sa précision). Un ON qui accepte le flou clinique… vous rend un mauvais service.
Do / Don’t – Le réflexe CECP
| ✅ À faire (Do) | ❌ À éviter (Don’t) |
| Harmoniser les indications et la cible patient dans tous les documents | Utiliser des termes différents selon le livrable |
| Définir clairement les seuils d’inclusion/exclusion cliniques | Être vague sur la population cible |
| Justifier chaque allégation clinique avec des preuves | Multiplier les bénéfices non documentés |
| Construire un PMCF spécifique aux risques du DM | Copier-coller un plan PMCF standard |
| Anticiper le niveau d’exigence des experts dès l’étape CER | Se reposer sur l’ON pour “filtrer” les incohérences |
| Poser des questions à l’ON sur le CEAR final | Découvrir l’avis du panel trop tard |
La CECP n’est pas un piège tendu par l’Europe aux fabricants. C’est un stress test objectif : il met en lumière les failles qui auraient pu rester invisibles… jusqu’à un incident post-commercialisation.
5. Cas pratiques
Pour bien comprendre l’impact concret de la procédure CECP, rien ne vaut une mise en situation. Voici deux scénarios typiques que nous rencontrons dans l’accompagnement de fabricants. L’un montre comment anticiper intelligemment les exigences ; l’autre… comment se faire piéger, même avec un organisme notifié bienveillant.
✅ Cas n°1 : Un dossier solide, qui passe la CECP sans heurts
Dispositif : stimulateur implantable de la motilité intestinale (classe III)
Fabricant : PME française avec une première expérience en marquage CE sous MDR
Ce qui a été bien fait :
- Le CEP définit dès le départ une stratégie d’évaluation clinique réaliste, basée sur une littérature ciblée et une étude clinique pilote pertinente.
- La cible patient est clairement délimitée : adultes entre 18 et 75 ans, avec critères d’inclusion/exclusion reproductibles.
- Le CER suit une structure claire, en lien direct avec les exigences du CEP.
- Le PMCF prévoit un registre multicentrique sur 5 ans, déjà budgété et planifié.
- L’ON est impliqué tôt dans la discussion sur la CECP, et le fabricant relit et discute le CEAR avant envoi au panel.
Résultat : L’avis CECP mentionne quelques suggestions d’amélioration du PMCF, mais aucune réserve majeure. L’ON délivre le certificat dans la foulée, sans blocage.
❌ Cas n°2 : Un dossier flou, stoppé net par le panel
Dispositif : générateur d’ozone portable pour plaies infectées (classe IIb)
Fabricant : start-up européenne avec un historique en cosmétique
Ce qui a été problématique :
- Le CEP a été rédigé sur un modèle générique, sans personnalisation ni alignement avec le dispositif.
- Le CER utilise des publications sur l’ozone en milieu aquatique (!) pour justifier son usage en cicatrisation cutanée.
- Le PMCF est une simple enquête de satisfaction patient prévue “à voir” post-lancement.
- L’ON (débordé) accepte un CEAR sommaire, sans remise en question des hypothèses du fabricant.
- Le nom du produit varie entre les documents, les indications changent selon les versions linguistiques.
Résultat : Le panel CECP rend un avis défavorable, soulignant des faiblesses méthodologiques majeures, une absence de données cliniques pertinentes, et un PMCF hors-sujet. L’ON est obligé de suspendre l’évaluation, avec retour complet au fabricant.
Dans les deux cas, la clé n’est pas la taille du fabricant, ni même la “valeur clinique” du dispositif. Ce qui fait la différence, c’est la rigueur documentaire, l’anticipation des attentes, et la capacité à challenger (et être challengé par) l’ON.
6. Mini FAQ – Tout ce que vous avez (vraiment) besoin de savoir sur la CECP
Quand la CECP est-elle obligatoire ?
La CECP (Clinical Evaluation Consultation Procedure) est obligatoire pour :
- Les dispositifs implantables de classe III, sauf exceptions prévues à l’article 54 du MDR ;
- Les dispositifs de classe IIb destinés à administrer ou retirer un médicament, une substance ou des fluides du corps.
Ce n’est pas au fabricant de la déclencher : c’est l’organisme notifié qui identifie si le dispositif entre dans ce champ.
Peut-on échanger avec le panel d’experts ?
Non, aucune interaction directe n’est prévue entre le fabricant et le panel. Le panel travaille à partir du rapport d’évaluation clinique de l’organisme notifié (CEAR) et, éventuellement, d’éléments annexes (CER, PMCF plan…). L’échange se fait uniquement entre le panel et l’ON, et le fabricant n’a pas accès aux discussions internes.
L’avis CECP bloque-t-il automatiquement le marquage CE ?
Pas nécessairement. L’avis du panel est non contraignant, mais il est hautement influent. Si le panel émet des réserves, l’organisme notifié peut :
- suivre ces recommandations,
- ou décider de passer outre, mais il devra justifier en détail cette décision dans son rapport final (Annexe IX, section 5.1.g).
Dans les faits, un avis CECP défavorable complique fortement l’obtention du certificat CE.
Que se passe-t-il si l’organisme notifié ne suit pas l’avis du panel ?
Il peut le faire, mais à une condition : il doit fournir une justification technique et scientifique détaillée, et l’argumentation sera scrutinée en cas d’audit ou d’investigation réglementaire.
Autrement dit, ce n’est pas une simple “option” que l’on écarte. Un ON qui ignore l’avis CECP prend un risque de non-conformité, voire de retrait d’accréditation s’il ne peut pas démontrer son raisonnement.
Comment se préparer en tant que fabricant ?
- Anticipez la CECP dès l’étape de planification clinique (CEP).
- Rédigez un CER structuré, cohérent, et rigoureusement sourcé.
- Préparez un PMCF spécifique, connecté aux risques résiduels.
- Vérifiez que tous vos documents racontent la même histoire (même nom, même indication, même cible patient…).
- Challengez votre organisme notifié sur le contenu du CEAR avant sa soumission.
Et surtout, ne laissez pas votre ON affronter seul le regard du panel. Vous n’y êtes pas invité… mais votre travail, lui, y sera disséqué.
7. Conclusion – La CECP n’est pas une sanction, c’est un stress test
Trop souvent perçue comme une menace ou une contrainte supplémentaire, la procédure CECP n’est pourtant ni punitive, ni arbitraire. Elle joue un rôle bien précis dans l’architecture du règlement MDR : tester la robustesse clinique d’un dispositif là où le risque pour le patient est le plus élevé.
En ce sens, la CECP agit comme un stress test réglementaire. Elle ne se contente pas de vérifier la présence d’un CER ou d’un plan PMCF : elle évalue leur cohérence, leur crédibilité, et leur lien direct avec la sécurité et la performance du dispositif.
Une opportunité de se distinguer Pour les fabricants sérieux, bien préparés, la CECP peut devenir un levier de légitimité :
- Elle pousse à formaliser une stratégie clinique cohérente et documentée.
- Elle permet de structurer les échanges avec l’organisme notifié sur des bases scientifiques solides.
- Elle renforce la crédibilité du dispositif sur le long terme (notamment pour les marchés hors UE ou les futurs audits).
Autrement dit, ce n’est pas la CECP qui met un fabricant en difficulté. Ce sont les approximations, les incohérences documentaires ou les justifications cliniques superficielles qui finissent par se retourner contre lui.
8. Besoin d’un dossier clinique qui résiste à la CECP ?
Vous développez un dispositif médical soumis à la procédure CECP ? Vous savez que votre organisme notifié ne pourra pas tout rattraper… et que la cohérence de vos documents cliniques sera passée au crible.
Chez CSDmed, nous vous accompagnons dès l’amont pour :
- Structurer une stratégie clinique alignée avec les exigences du MDR,
- Construire un CER robuste et cohérent, prêt à soutenir l’évaluation,
- Élaborer un plan PMCF sur-mesure, en lien avec vos risques et votre stratégie de marché,
- Et dialoguer efficacement avec votre organisme notifié, sans attendre le verdict du panel.
Un dossier bien préparé n’a rien à craindre de la CECP. Mais il ne s’improvise pas.
Contactez-nous pour discuter de vos projets.